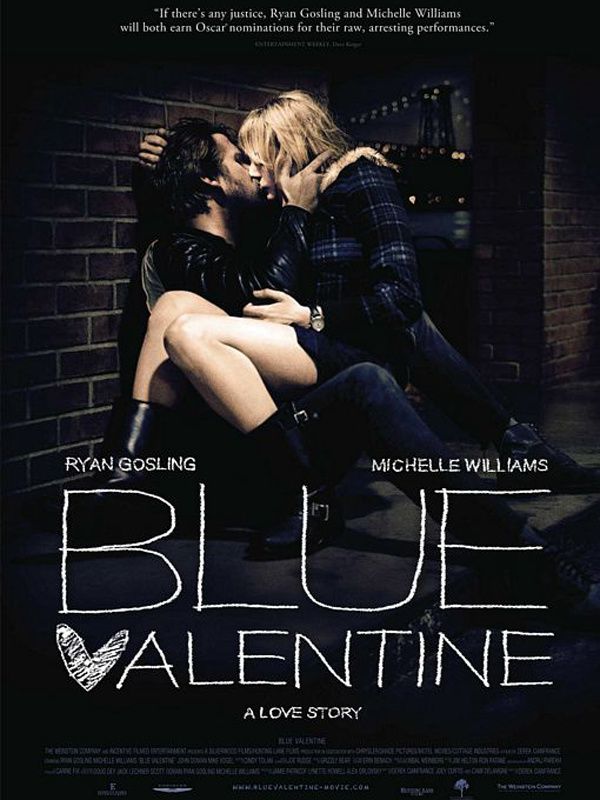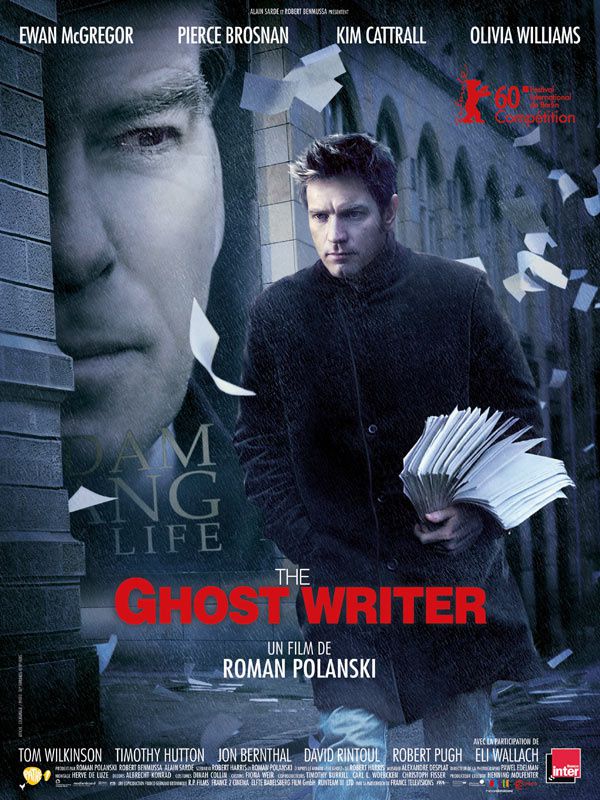Pour son premier film, Terrence Malick pose déjà les bases de son cinéma, et impose un duo de personnages totalement atypique.
Au fur et à mesure des créations de Malick, une tendance notable se fait sentir: le cinéaste américain se débarasse de plus en plus des conventions narratives pour ne formuler que des impressions, des sensations, en s'appuyant sur une mise en scène toujours plus panthéiste. En cela, La balade sauvage, son premier film, contient encore une narration classique et s'affirme comme le récit le plus structuré de son auteur. Ici, la nature occupe déjà une place prépondérante, et nourrit les réflexions du cinéaste, mais le film se singularise par ses deux personnages principaux. Malick filme leur cavale à la façon d'une balade désincarnée: unis par un amour beaucoup plus fort qu'il n'y paraît, Kit et Holly éliminent tous les obstacles qui se dressent sur le chemin, avec une indifférence qui fait froid dans le dos. Martin Sheen confère à Kit cette nonchalance et cette désinvolture d'un homme totalement dérangé, qui, pour préserver son amour pour Holly, n'hésite pas à assassiner des gens de sang-froid. Quant à Sissy Spacek, elle prête ses traits à Holly, cette jeune fille lunatique, mystérieuse, qui ne connaît rien de la vie, et se croit toujours aussi innocente malgré les meurtres auxquelles elles assistent passivement: son personnage fait d'ailleurs preuve d'une froideur inhumaine face à la mort de son père. Ce couple se crée un monde à lui, avec ses propres règles. Le contraste naît de la différence entre l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et ce qu'ils sont vraiment. A de multiples moments, Malick fait naître un décalage, un humour cynique, qui souligne la folie masquée du personnage de Kit: après avoir planqué le cadavre du père de Holly dans la cave, il remonte dans la cuisine avec un grille-pain, prétextant que cela pourrait être utile. C'est un exemple parmi tant d'autres qui fait comprendre au spectateur l'état d'esprit de Kit. Pour autant, le cinéaste refuse toute explication psychologique, ce qui est d'autant plus terrifiant: les personnages semblent dépossédés d'eux-mêmes, en totale absence d'empathie envers ceux qu'ils tuent. Seulement, en contre-point, Malick leur confère une certaine part illusoire d'innocence, une sorte d'humanité sensible qui rend ce couple attachant: en cela, La balade sauvage est un film particulièrement dérangeant. Le cocon d'irréalité qui les maintient dans un état d'esprit désincarné a beau être rompu par la trahison d'Holly (elle ne veut plus le suivre, pour la première fois il s'énerve), Kit continue à "jouer un rôle", même après son arrestation et la sentance prévisible de condamnation à mort. A de multiples reprises, le style naissant du cinéaste se fait sentir: si La balade sauvage fait moins dans la contemplation que ses films suivants, tous les ingrédients sont en germe ici. Le contraste entre une nature belle mais indifférente à la violence des hommes est déjà exploité ici: elle apaise, elle donne un sentiment de refuge aux personnages, loin du monde, loin des hommes.
Si les pistes de réflexion sont plus abouties, La balade sauvage n'atteint pas le choc visuel des Moissons du ciel, le deuxième film du cinéaste. Néanmoins, le premier film de Terrence Malick regorge d'ambiguités et de trouvailles d'une maîtrise rare. Injustement boudé à sa sortie, il mérite d'être redécouvert.
8/10